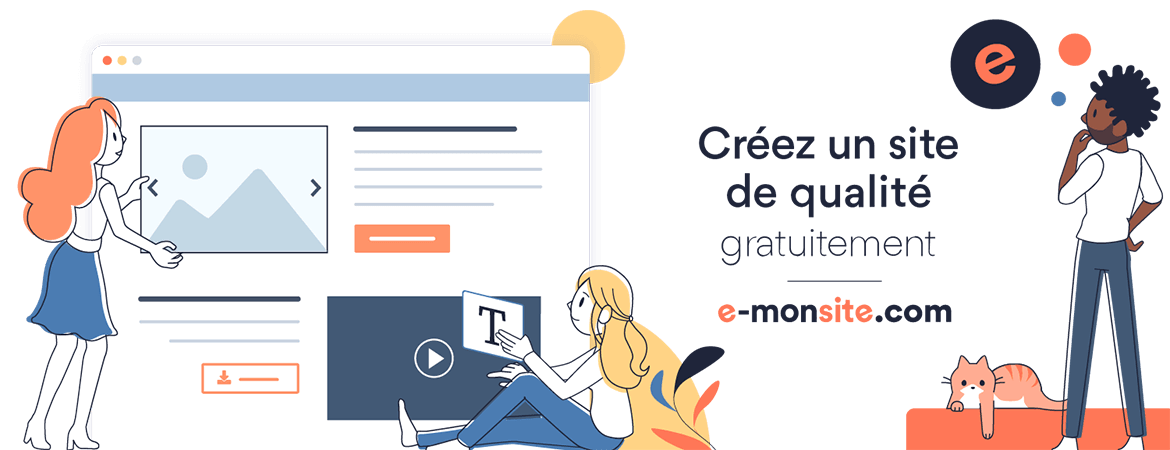Lundi 2 octobre 2023
Salle du Manège
Je reviens de l’Opéra Rennes. Hier y était représentée Le Couronnement de Poppée de Monteverdi. La mise en scène révélait l’aspect illusoire du manichéisme, ce concept des extrêmes qui oppose le Bien et le Mal. Voilà une thématique bien inspirante… Alors, dès mon arrivée à la gare Montparnasse, je m’engage tout droit dans la rue de Rennes. Je marche comme à mon habitude, à vive allure. En quarante minutes je suis au musée du Louvre. Je suis en sueur comme si, de ma venue, ma vie en avait dépendu. Je me faufile au travers de la masse des touristes. Qu’ils sont lents, incertains. A peine sont-ils entrés qu’ils semblent perdus. Leurs yeux hagards trahissent une once de désespoir devant tant de beautés qu’ils savent ne pas pouvoir apprécier pleinement, par manque de temps. D’autres paraissent davantage perdus car ils ne savent pas bien ce qu’ils font là. Que peut-on bien regarder, lorsque l’on n’a pas l’habitude de prendre le temps d’admirer ?
Comme la fois dernière, je me laisse mener par mes pas. Je me retrouve alors dans la salle du Manège. Je me pose, enfin, sur un haut banc. Outil pratique de repos succin, beaucoup moins pour y rester. Je profite néanmoins de cet ermitage tout relatif, un rien en retrait du flot des visiteurs. Ici se trouve la collection des statues grecques antiques. Les dieux romains y côtoient Antinoüs et Alexandre le Grand. Ces personnalités grecques déifiées y trouvent leur place devenue naturelle, pétrifiées dans leur beauté parfaite, idéalisée même puisque le jeune amant d’Hadrien bénéficie du corps même d’Hercule. Ça, je l’ai lu, je ne l’aurais pas deviné par moi-même… Bacchus est un dieu jeune aux courbes presque féminines. Son visage portant une longue chevelure décorée de grappes n’en est que davantage trompeur. Sa position lascive et son expression triste ne donnent pas forcément envie de louer les plaisirs d’une jeunesse insouciante. Jupiter lui fait face, levant une foudre menaçante bien que son expression faciale paraisse bienveillante, paternelle même. Tout proche, un imposant buste d’Antinoüs montre une beauté juvénile dont le torse musclé prouve pourtant une maturité affirmée. Ces statues ne sont que paradoxes. Les dieux (et les déifiés) ont été tantôt cruels tantôt généreux, emportés d’amour comme de colère. Ont-ils été bons ou mauvais ? La morale ne les inquiète pas. Ils n’ont jamais été l’un ou l’autre. Ils ont été, tels qu’ils ont été. Seule la beauté et la perfection de leur représentation semblent leur être important, ainsi figés pour l’éternité.
Apollon vainqueur du serpent Python / Gianfrancesco Rustici – Galerie Michel-Ange
Il y a bien un dieu qui fascine, non seulement par sa beauté, par sa bonté. Enfin, c’est ce que je veux retenir de lui. Apollon a vaincu le vilain serpent Python. Une statue de bronze le montre terrassant le monstre, non loin de là. Lui aussi, comme Bacchus, pose d’une manière singulière, mettant en avant des formes très légèrement rondes avec une chevelure douce et longue. Avec son bras posé sur sa tête, il fait écho à l’esclave captif qui lui fait face. Moins expressif, son visage ne semble toutefois pas souffrir comme son malheureux voisin. La victoire lui était aussi facile que naturelle. Habillé d’une minuscule bandoulière qui devait tenir son carquois. Son arc n’est déjà plus qu’un souvenir, petit bout qui reste dans sa main gauche. Sa nudité rappelle qu’il est un dieu et qu’il n’a nul besoin d’autre apparat que lui-même et ses éventuels attributs. Cette œuvre du XVIe siècle a inspiré l’œuvre éponyme en marbre, un siècle plus tard, sans qu’elle ne m’éveille autant d’inspiration que celle en bronze, noire et profonde. Il ne me faut que peu d’efforts pour me laisser monter le monumental escalier Mollien, comme si je suivais un appel divin vers les hauteurs.
Le Pandémonium / John Martin – salle 713
Mais c’est dans une salle sombre que j’atterris, devant un tableau vers lequel tout œil se laisse happer. Il est fréquent d’y rencontrer des visiteurs qui, en transit de la Grande Galerie à la Galerie Mollien et sans correspondance saturée par la salle de la Joconde, dévient leur trajectoire vers cette œuvre aussi fascinante que formidable. Le Pandémonium de John Martin ne semble éclairé que par la mer de lave qui s’agite sur sa toile. On ne voit d’abord que lui : Satan. Il est debout devant cette mer rouge, brûlante et mouvante. De l’autre côté, on aperçoit l’ombre d’un palais immense, le pandémonium, capable d’accueillir tous les anges déchus. En y regardant de plus près, on les aperçoit même : ils sont des dizaines voire des centaines de milliers de démons, bien rangés en une armée irréductible. Ils sont si nombreux et si petits sur la toile que l’on ne peut qu’en être impressionné et en ressentir une certaine crainte. Nous sommes trop loin pour voir leurs visages et pourtant on sent bien la chaleur qui émane de cet Enfer. Au-dessus d’eux, le long du palais et soutenu par des arches, court une rue étonnamment éclairée par des lampadaires. La petite touche de peinture blanche qui créé la fine lumière qui s’en échappe apporte une élégance inattendue voire absurde. Mais nos yeux reviennent vers ce Belzébuth impérieux et déjà victorieux. Il lève les bras devant son armée. Il n’a pas besoin d’ouvrir la bouche pour les exhorter à le servir de tout leur être. Le visage sévère, il paraît tout puissant. Il est Hadès, maître de ce palais qui abrite les forces maléfiques. Il est Arès, vêtu d’une cuirasse magnifique, prêt à défendre son royaume de feu. Il est Jupiter, prêt à frapper celui qui se montrerait infidèle. Il est tout-puissant, ne crains rien ni personne et son pouvoir est incommensurable. Finalement, il est certainement Dieu lui-même. Le Mal et le Bien, il les porte en lui. Il est le garant d’un équilibre, d’une harmonie parfaite, qui régit l’ordre universel. S’il n’y avait que l’un ou l’autre, si les mondes basculaient sans retenue sur l’un des flancs minces de sa haute position divine, alors ce serait le chaos.
Galerie Mollien
Alors que je me perds dans ces pensées et crée une théologie nouvelle, le tableau ne cesse d’attirer de nouveaux visiteurs. La salle est petite mais le flux humain ne cesse jamais. Bien qu’égarés, les touristes dérivent systématiquement vers les couleurs flamboyantes de ce tableau. Je commence à étouffer. Je sors de la collection anglosaxonne, je me retrouve dans la salle Mollien. Les tableaux y sont immenses, magnifiques. Mais il y a tant de gens, tant de visages. Ils marchent, ils s’arrêtent, ils regardent, ils s’évitent. La salle est haute mais je manque d’air. Je presse le pas, comme pris de panique dans cette foule. Les bouches d’aération au sol me sont de vains réconforts. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à les apprécier, certains visiteurs s’y arrêtant pour rafraîchir, plus ou moins discrètement, le dessous de leur jupe. Je passe rapidement devant des tableaux incroyablement connus. Je les connais et je ne pourrais les admirer avec tant de gens devant. Je laisse trainer deux secondes sur l’œuvre d’Antoine-Jean Gros, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa. Cette représentation, indéniablement issue d’une commande de propagande, m’a toujours beaucoup intriguée, au-delà de son intérêt artistique. Mais la foule m’oppresse. Je ne peux m’arrêter. Même devant L’Âme brisant les liens qui l’attachent à la terre de Pierre-Paul Prud’hon, dont le corps tout pâle ne peut qu’attirer une attention particulière, je continue mon chemin en quête d’air et d’espace. Je fuis la sale Denon, échappatoire des touristes ayant passé des heures dans la file d’attente pour « admirer » (comment admirer un tableau derrière une double-vitre, à deux mètres de distance avec six agents ?!) la Joconde. Je poursuis ma course dans la salle Daru et arrive devant la Victoire de Samothrace. Je me souviens de l’émerveillement que j’éprouvais, auparavant, devant l’escalier monumental, scène spectaculaire sur lequel trône cet extrait d’une œuvre encore plus monumentale. Aujourd’hui, comme lors de mes dernières visites, c’est devenu une véritable angoisse, comme avant de se jeter dans un parcours du combattant. La horde d’admirateurs occupe presque toutes les marches. Le bruit des pas et des paroles résonnent dans l’escalier immense. Il est énorme. Le bruit. Je me faufile comme je peux. J’arrive devant la Galerie d’Apollon. Je ne m’arrête pas. Je résiste à me laisser emporter par l’écoulement incessant qui s’y engouffre. Ô bonheur, je découvre la salle aux sept cheminées, tout récemment réouverte après des mois de fermeture. Mais il n’y a aucun endroit où se poser, admirer et noter dans mon carnet mes impressions…
Galerie Campana – salle 651
Ça y est, j’ai trouvé refuge en la Galerie Campana. Les visiteurs se laissent peu aller à la curiosité de découvrir ces salles en enfilades regorgeant d’objets en terre cuite. La céramique grecque antique n’est pas forcément ce qui attire l’œil en premier lieu. Il faut prendre le temps de regarder la finesse de certains vases et surtout de leurs décors. Alors que j’ai trouvé un banc où me remettre de mes émotions agoraphobes, une visiteuse étrangère m’interpelle en anglais. Je lui souris et lui fait comprendre ma disponibilité pour l’assister. Mais ne voyant pas de badge, elle s’inquiète et me demande si « je suis d’ici ». Je ne suis pas assez habitué des lieux pour avoir la prétention d’être ici chez moi. Je réponds donc négativement. Elle s’excuse et repart. J’aurais sans doute pu l’aider, au moins aussi bien que certains agents non bilingues et parfois fort peu coopératifs avec les admirateurs étrangers. Tans pis. Je serai tranquille et cette femme saura bien se retrouver, les yeux rivés sur les écrans de sa console 3DS.
Outre les céramiques, la galerie du bord de l’eau offre de très beaux plafonds peints honorant les plus grands monarques de France. Bonaparte est d’ailleurs non loin, caché dans l’ombre d’une khaïne dans L’Expédition d’Egypte sous les ordres de Bonaparte de Léon Cogniet. Si cette expédition militaire fut un échec complet, le général en chef ayant finit par abandonner son armée malgré son geste christique sur les tumeurs des pestiférés de Jaffa. La veille de sa visite à l’hôpital de Jaffa, il avait fait exécuter près de 3000 prisonniers à qui il avait pourtant promis la vie sauve. C’est quelques jours plus tard en grand vainqueur qu’il réapparait néanmoins en France. C’est qu’auréolé des découvertes de ses équipes de scientifiques, Bonaparte était fin prêt pour accueillir son destin des plus éclatants. Là encore, le mal s’estompe dans le bien, ou inversement.
Département des antiquités égyptiennes
Je me laisse alors convaincre par cette figure mystérieuse sous cette tente bédouine pour admirer les antiquités égyptiennes, descendant l’escalier du Midi. Les œuvres sont si nombreuses que je ne m’y retrouve pas. Il m’est arrivé de passer du temps à les scruter, sans qu’elles ne parviennent à me toucher, sauf exceptions notables. Fascinante, la culture de l’Egypte antique nous est tout de même bien éloignée. Le concept divin diffère beaucoup de celui du polythéisme grec et romain. Les dieux sont garants du bien et leur magie prévient des forces maléfiques. Je remonte, traverse les anciens appartements royaux puis le Musée Charles X. Il me faut trouver la sortie. L’angoisse des visiteurs trop nombreux me reprend. Les espaces me paraissent trop petits. Je ne fais même pas attention aux plafonds aux oiseaux réalisés par Georges Braque de la salle Henri II (ce fut sa royale chambre), ni le vaste Ceiling de Cy Twombly en la salle des bronzes. Je trouve enfin l’un des escaliers du pavillon Sully. Je m’y engage. J’ai cru avoir semé les touristes, ils sont plus nombreux encore en bas. Il y a bouchon. Ils sont perdus et s’arrêtent en plein milieu des passages… Je parviens tout de même à atteindre le grand hall sous la Pyramide de verre. Le bruit n’est que plus présent. Il y a des classes de jeunes élèves, fatigués d’une longue visite dans les salles du plus grand musée du monde. Moi aussi, je suis fatigué. J’ai près de 8 kilomètres dans les pieds sans avoir mangé de la matinée. La lassitude et la faim font que le bruit devient un véritable supplice. Plus que quelques mètres dans les larges couloirs du Carrousel. Encore des marches, encore des escaliers. Après en avoir descendu, il faut en monter. C’est ce que je préfère. Je monte deux par deux les dernières marches et me voici enfin à l’air libre. Le soleil de cet été tardif m’éblouit, réfléchi par la blancheur du stabilisé. Ce revêtement imaginé par Le Nôtre, réalisé à partir d’un mélange de chaux, de gravier et de sable, est unique. Mais piétiné par des dizaines de milliers de promeneurs, le stabilisé devient une poussière blanche qui s’envole au moindre coup de vent et m’aveugle. Il faudra attendre le bus, puis rentrer chez soi.