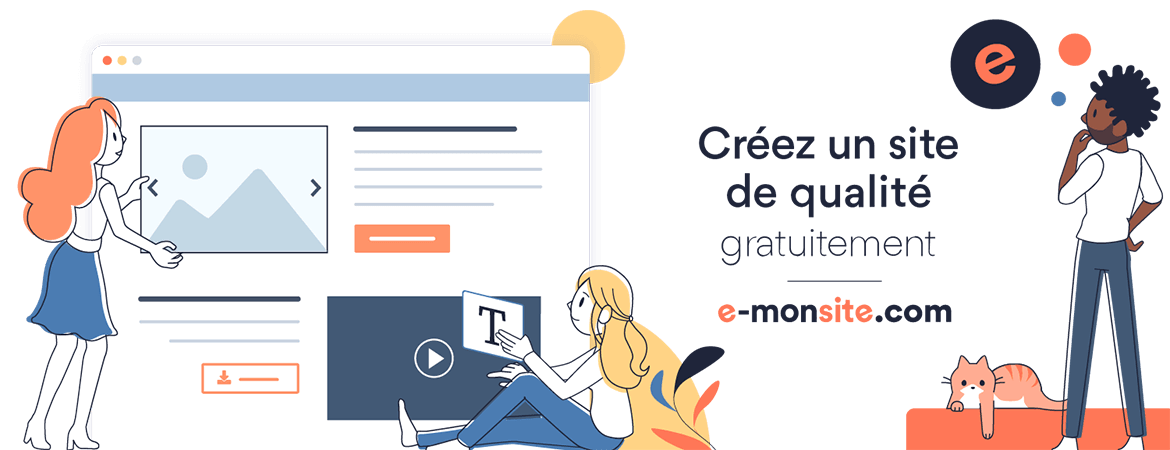Lundi 18 septembre 2023
En allant au Louvre...
Ce sera sans doute ma 20ème visite au Louvre. Peut-être ma 21ème. Je me souviens encore, adolescent, découvrir ses immenses galleries, seul ou avec ma mère. Avec des amis aussi. J'étais parfois fier de leur faire découvrir des ailes qu'ils ne connaissaient pas encore. On dit que c'est le plus grand du monde. Je n'en doute pas. Je reste même persuadé que c'est l'un des plus beaux du monde. Pourtant, après tant de visites, j'ai commencé à me lasser. Il m'a fallu du temps pour ne pas être surpris moi-même par une nouvelle salle. Mais est arrivé la visite qui a semblé de trop. J'ai finis par errer, lassé de tant de beautés que je ne savais plus admirer. C'est que, malgré ma curioisté, mes connaissances restent très limitées. Les quelques codes en ma possession ne me permettent pas de comprendre et d'apprécier tous les détails des oeuvres. Je les connais ; elles se sont brièvement présentées à moi lorsque je me suis arrêté devant elles. Mais jamais la rencontre ne fut réelle. Ce ne sont que des connaissances que l'on croise au détour d'une salle de musée.
Mais il m'est venu une idée. L'écriture permet de partager ce que l'on ne connait pas, parce que la sensation et l'émotion sont, grâce aux mots, légitimisés. Dans un carnet, dédié à mon aventure modestement littéraire, je ferai parler les oeuvres. J'exprimerai la vie qu'elles suscitent dans mon imagination. Mais par qui commencer ? Quelle oeuvre encouragera donc mon inspiration ?
Le trajet de chez moi au Louvre me permettra peut-être de planifier un plan d'attaque. Quand le temps me le permet - quand je vais au Louvre donc -, je prends le bus. D'abord pour des raisons purement économiques, le bus me permet de me laisser aller à la lecture. Montant dès le premier arrêt, je n'ai pas de difficulté à trouver une place assise, celle que je veux : presque au fond, à gauche, près de la fenêtre. J'évite ainsi les circulations des passagers. Le lundi matin, c'est mon jour de récupération. C'est toutefois le premier jour de la semaine de la majorité des travailleurs, encore nombreux à se rendre sur leur lieu de travail à 9h30. Certaines odeurs m'incommodent. Est-ce moi ? Non, elles sont trop différentes, trop nombreuses. Quand ma muqueuse nasale commence à piquer trop fort, je ne peux m'empêcher de me mettre le dos de la main sur mes narines. Réconfort... Je découvre que le nouveau savon que j'ai récemment acheté n'est pas si désagréable. C'est sans doute peu naturel mais sa promesse de fraîcheur est tenue. La nationale 20 est morose. Je lis ou me laisse partir à imaginer la route au XIXème siècle : reliant Paris à Orléans, elle devait être majestueuse, remplie de charettes, de chevaux, de piétons... Que de bruits, que d'odeurs insoutenables mais que d'animations ! Quelques maisons meulières subsistent sur le côté de la route, souvenirs d'un charme d'une banlieue campagnarde qui s'est bien éloignée depuis. Peut-être n'était-ce pas si bondé et la vie y était calme et douce... Nous arrivons à la Porte d'Orléans. A pieds, il est tout de même plus commode de traverser ce carrefour infernal où même les automobilistes les plus attentifs ne parviennent à respecter la priorité des feux. Je monte dans le bus 68 et le paysage change tout comme les passagers. Il y est plus difficile de lire : Paris et les parisiens se laissent volontiers admirer. Au milieu d'une nouvelle rêverie, dont le souvenir s'échappe immédiatement, le bus s'engage sur le Pont Royal. On a beau y passer souvent, on ressent toujours la même petite émotion en surplombant la Seine. Tout proche, le Musée d'Orsay ; au loin, le Grand Palais. C'est tout de même bien beau.
On descend à l'arrêt "Pyramides Saint-Honoré". Pas facile quand on est touriste de savoir que c'est ici qu'il faut descendre pour le Musée du Louvre. Après, il suffisait de regarder, on est passé juste en dessous des Tuileries disparues ! A partir d'ici, je ressens toujours comme le besoin de me précipiter. Le rythme de Paris m'anime. La lenteur des touristes m'exaspère. Je file, en me modérant, sous les arches de la rue de Rivoli. Ces magasins de souvenirs, petits et sans charme, ne m'intéressent pas. J'arrive au passage de Richelieu. Je descend les escalators, j'en remonte un. C'est bon, j'y suis. Je suis au Louvre.
Spartacus / Denis Foyatier - Cour Puget
Je n'ai pas réfléchi à une oeuvre pour ma première rencontre. Je me laisse alors porter. Mes pas me mènent tout seul vers le département des sculptures françaises, dans la cour Puget. Le lieu est encore relativement épargné par les hordes de touristes. Les terrasses de la cour, éclairées naturellement, laisse les nuages décider à leur guise de l'intensité de la luminosité, tantôt chaude, tantôt douce. Sur la plus haute esplanades se tient Spartacus. C'est devant lui que je m'arrête.
Malgré sa nudité et sa musculature parfaite, virile et équilibrée, c'est son regard qui m'interpelle. Il est dur et pensif. On y sent toute sa haine pour ses oppresseurs et son désir de vengeance. De sa main gauche, il vient à l'instant d'arracher ses chaînes. Il les tient tout contre lui, contre sa gorge. Il semble les serrer encore, bien fort, ces fers qui ne l'ont pas quitté pendant si longtemps. Craint-il de s'en séparer ? Spartacus est conscient qu'il ne pourra jamais revenir en arrière. Dans quelques instants seulement, il les jettera loin de lui, avec une violence qu'il ne saura maîtriser. Ses yeux regardent loin et ne font place à aucune once d'hésitation. Son destin promet d'être douloureux. Il est prêt à affronter sa fatalité.
Dans sa main droite, caché derrière ses bras croisés, l'esclave rebelle tient fermement son glaive. Son poignet est encore prisonnier de son fer. Il est certes libéré de ses chaînes, il garde un souvenir de son esclavage. Ses souffrances ne s'oublieront pas si facilement.
Et puis, on se laisser frapper par l'oeuvre et la beauté parfaite de cet homme. Il est bien plus grand qu'un homme réel et nous impose sa stature depuis son piédestal. Il est en posiiton de repos, en pleine réflexion, et pourtant ses muscles sont toniques, comme prêts à se mettre en action. Le nez très droit n'ajoute aucune courbe qui aurait pu adoucir son visage sombre par ses sourcils froncés. Ses lèvres trahissent une émotion plus subtile que la vengeance qui brille dans ses yeux. On y sent la colère mais surtout la tristesse de ceux qui sont morts et de ceux qui le seront. Spartacus devra tuer, sans pitié. Il ne pourra pas pleurer ; ses ennemis ne feront preuve d'aucune bonté.
La liberté, tout juste acquise, réclame déjà son prix. Spartacus l'a gagné mais son combat vient tout juste de commencer.
Le Génie de la Liberté / Auguste Dumont - salle 225
A quelques mètres de Spartacus, en suivant presque son regard, c'est justement le Génie de la Liberté que je rencontre. L'oeuvre en bronze est très différente de la précédente en marbre. Celle-là est une réplique en demi-taille de la statue dorée qui culmine tout en haut de la Colonne de Juillet, place de la Bastille. Le visage du génie, au regard sans âme, n'a donc pas eu droit à autant d'attention que pour Spartacus. L'ancien esclave est un homme bien avancé dans l'âge adulte alors que le génie est encore tout jeune. Son corps juvénil n'est pas formé par une musculature dûe aux efforts du travail et sa peau toute douce ne montre aucune aspérité du temps.
A cet instant, l'enfant s'élance, porté par ses ailes magnifiques. Il tient dans sa moin droite le flambeau pour qu'on puisse le suivre, même dans l'obscurité la plus tenace. Dans sa main gauche, il tient le reste des fers qui emprisonnaient les malheureux. Ces quelques maillons semblent incroyablement légers. Ils ont complétement perdu leur raison d'être et ne sont déjà plus que des souvenirs.
Le sculpteur a décidé de montrer l'instant même où le génie déploie ses grandes ailes, la pointe de son pied se détachant avec douceur de la terre. L'équilibre est parfait. L'instant suspendu en est superbe. La perfection du bronze me donnerait l'irrésistible envie de caresser cette liberté avant qu'elle ne s'envole. Ne pourrait-elle pas m'emmener, là-bas et tout là-haut ?
Quatre captifs / Pierre Franqueville & Francesco Bordoni - salle 216
Le Génie de la Liberté est sans doute parti trop vite. Un peu plus loin, je tombe nez à nez avec quatre captifs. Chacun est à un stade de vie différent. Ou est-ce le même captif à quatre âges de sa propre vie ?
Tous quatre sont comme assis inconfortablement, en équilibre instable. Initialement aux quatre coins d'une statue équestre à la gloire de Henri IV, la muséographie ose et forme deux binômes qui semblent se regarder et s'interroger. Le plus jeune ne peut cacher sa panique, questionnant de ses yeux expressifs son aîné, résolu à vouloir le rassurer. Mais sa tête est légèrement baissée laissant entrevoir sa tristesse. En miroir, celui qui pourrait être dans sa trentaine s'indigne de l'inaction de ses pairs. La colère de son regard se mêle l'incompréhension, de sa situation sans doute, mais surtout de l'attitude du vieillard qui lui fait face. Celui-ci ne semble pas faire attention à ses repoches. Ses yeux baissés trahissent son abbatement : il n'y a rien à faire. Il le sait car son expérience s'allie à sa sagesse : rien ne sert de s'épuiser devant la fatalité.
Le Génie de la Liberté s'est envolé. Il les a abandonnés. Son flambeau est trop faible pour qu'on puisse le suivre.
Les Quatre nations vaincues / Martin Desjardin - Cour Puget
Les Quatre captifs de Francqueville et Bordoni sont d'évidentes inspirations à l'ensemble monumental qui encadrait une statue équestre de Louis XIV. Imposante et accueillant une aprtie des visiteurs qui entrent dans l'aile Richelieu, l'oeuvre attire nombre de visiteurs.
L'expression des captifs semble plus intense encore, chacun d'entre eux ayant droit à une position différente et ainsi plus "personnelle". Véritablement disposés aux quatre coins du piédestal, ils sont également isolés les uns des autres, s'exprimant seuls. Leur désespoir n'en est que plus grand.
Le plus jeune (l'Espagne) ne semble toujours pas comprendre l'injustice imposée aux vaincus et se montre encore prêt à se battre et à défendre sa liberté. Le guerrier plus mûr (la Hollande) nous jette un regard farouche, sans peur. Je suis presque rassuré que ses mains soient bien attachées dans son dos. Tandis que l'homme un peu plus âgé (le Brandebourg) se laisse complétement aller au désespoir, le plus vieux (l'Empire) semble abattu, conscient de son destin et de son impuissance.
Salon de Madame Récamier / Jacob Frères - salle 557

Il me prend le désir d'errer un peu plus loin dans le palais, de monter les escalators de l'aile Richelieu (qui aurait cru que des escalator puissent paraître aussi beaux ?) et de me poser brièvement dans le département des objets d'art. J'y rencontre non pas une personne mais son souvenir grâce au mobilier de son salon. Je m'invite chez Juliette Récamier.
Souvent, on se plaît à visiter des salons royaux ou princiers, opulent de richesse que l'on sait innaccessible. Les ors émerveillent jusqu'à parfois l'écoeurement. Ici, on est plongé, sans décor, dans un salon bourgeois du XIXe siècle. Quelques tableaux en frise de Pierre-Paul Prud'hon habillent discrètement les murs dont le bleu acier répond parfaitement à la couleur des assises du salon. Le mobilier est relativement simple, dans le style néo-classique en vogue lors du Consulat. Il tiendrait parfaitement dans mon propre salon, aux dimensions pourtant bien modestes. Il n'y a pas de table basse sur laquelle on pourrait poser ses pieds avec nonchalence. C'est un beau guéridon qui occupe le centre de la pièce, entouré de fauteuils et de bergères. Je m'imagine une rencontre amicale autour d'un café, d'un thé ou même d'une aprtie de cartes. Seuls quelques éclats de rire perturbent cette douce atmosphère propice aux confidences. Un élégant secrétaire à cylindre, sur le côté, invite à l'art épistolaire. Y couchions-nous sur le papier des secrets destinés à nos plus proches amis ? Le meuble reste fermé et cache encore aux yeux de l'admirateur ses plus tendres mystères.
Cour Marly
Majestueuse et fraîche, j'aime souvent me poser à la Cour Marly. Après mes visites au Louvre, j'aime y faire un détour, un bref passage. Il n'y manquerait q'une fontaine pour parfaire cet espace unique où règne le calme. Une photographie discrète rappelle qu'ici, avant le chef-d'oeuvre architectural de Ieoh Ming Pei et de Michel Macary, était la cour du Ministère des Finances. J'aurais été M. Balladur, j'aurais aussi voulu y rester ! S'il me prend parfois de rêver de cette époque mystérieuse, c'est plus loin encore que s'évade mon imagination : je fantasme sur les jardins de Marly dans lesquels le Roi Soleil aimait se promener, au milieu de la statuaire d'inspiration mythologique et ici déplacée, à l'abri de la pluie et du vent.
Je suis toujours émerveillé par le pouvoir des sculptures. Qu'elles soient de marbre ou de bronze, j'y vois du mouvement qui me raconte une histoire. Il y a un avant, un instant gravé dans le marbre ou fondu dans le bronze, et il y a un après. Par l'instant capté par le talent du sculpteur, l'avant et l'après appartiennent à l'admirateur. Parce que l'instant est devenu éternel, l'admirateur peut changer son angle de vue à désir et ainsi nourrir le passé et le futur du protagoniste. Toujours son regard découvre ainsi une nouvelle facette.
Si l'on veut apprécier sa prochaine visite, il est temps de repartir, de reprendre en sens inverse la N20 et de retrouver sa modeste réalité.